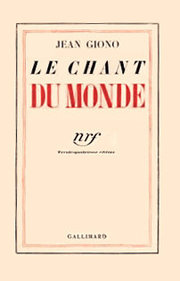Dans deux rubriques antérieures, j’ai parlé de mon coup de cœur pour les livres d’écrivains bien vivants. Cette fois-ci, j’évoquerai un livre plus ancien d’un écrivain qui nous a quittés en 1970, à savoir Le chant du monde, de Jean Giono. Je n’avais pas lu ce livre depuis si longtemps ! Mon plaisir s’est avéré intact et même bien supérieur à ma précédente et lointaine lecture des œuvres de ce magicien des mots, des phrases, de la Nature et des Sens.
Trois personnages émergent de cette histoire dure qui se déroule en Haute Provence : Antonio, dit « Bouche d’or », Matelot – parce qu’il a navigué sur les mers, autrefois –, Toussaint, Maudru, Gina.
Les descriptions du pays Rebeillard, du fleuve, de la forêt font « voir » ce que l’auteur raconte avec acuité. Sa connaissance des végétaux, des oiseaux, sa perception des couleurs, des senteurs… On peut dire que, de livres en livres, la Nature est sa patrie !
Les mots qu’il invente parfois sont incroyablement évocateurs : « Maintenant, le fleuve soubressautait. » Plus avant « Avec, de loin en loin, un érable “allumé” », pour dire que les feuilles rougeoient dans l’automne qui s’installe.
Oui, les descriptions sont telles que je viens de le dire, l’on « voit » les gens, les paysages, les choses quelles qu’elles soient. Certains passages, certaines phrases –mais on pourrait en citer bien d’autres- ont retenu mon attention éblouie :
« Les prés sentent fort dans ce pays, dit Antonio, et les arbres ont tant de sang que l’air en prend l’odeur rien qu’en passant entre les branches. »
« Les collines soudain embrasées ouvrirent leur danse ronde autour des champs et le soleil rouge sauta dans le ciel avec un hennissement de cheval. »(quelle belle image!)
« La porte s’ouvrit sans bruit. Antonio la sentit seulement qui s’amollissait contre son épaule en s’ouvrant. »

« Sur la place aux quais le hurlement du fleuve frappait les hommes en pleine figure. Il y avait de quoi être grave et inquiet. Les eaux n’avaient fait que monter tout le jour. Les glaçons se broyaient contre la clef de voûte. Parfois, au dessus du quai, le bord blême d’une vague luisait comme un dos de poisson… »
Je conclurai en disant : lisons, mais relisons également car, à la relecture, on découvre presque toujours de nouveaux trésors !
Fabienne Croze